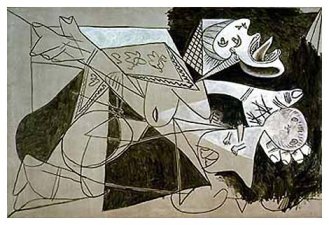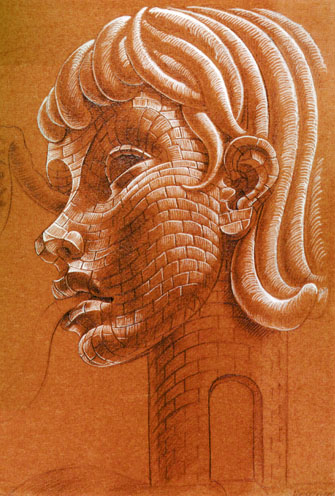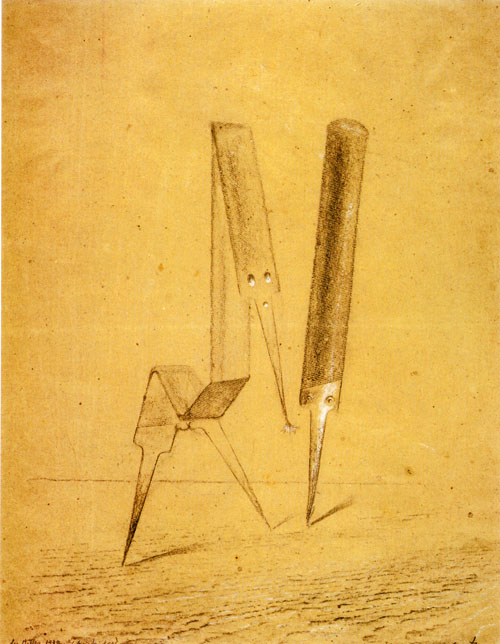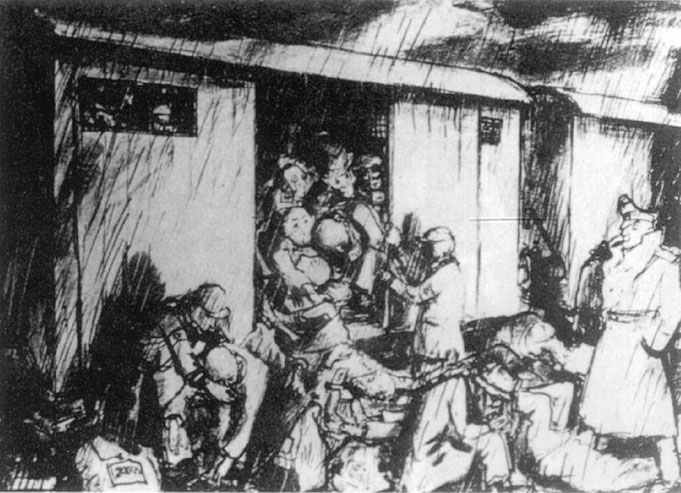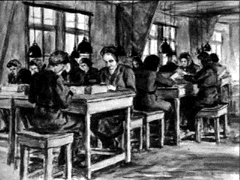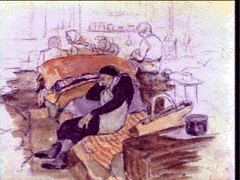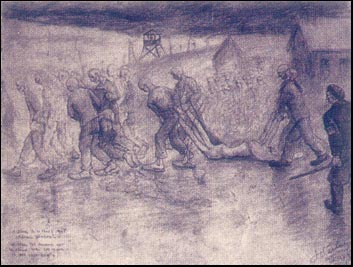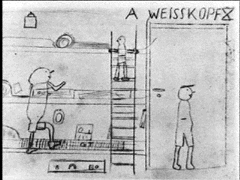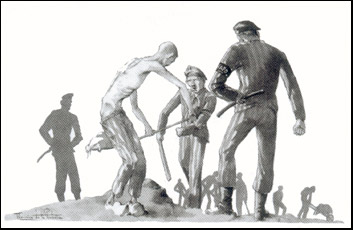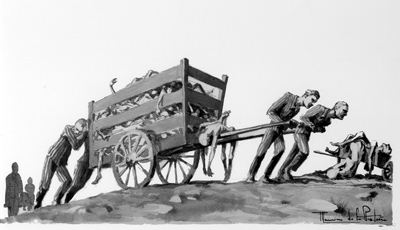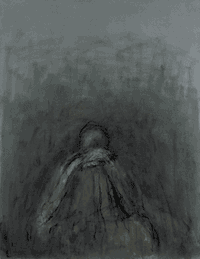En 1937, au Petit Palais
à Paris, l'Exposition Internationale rassemble une sélection
de grandes figures de l'art comptemporain français et européen
dans une grande confrontation pacifiste dans un climat mondial électrique,
envers et contre toutes les exclusions facscistes. Très atteints par
le début des horreurs de la guerre, et particulièrement en Espagne,
des artistes tels que Picasso, Matisse, Derain, Gonzalez, Laurens et Braque
revendiquent alors avec des oeuvres modernes leur droit au cosmopolitisme,
et à travers lui, leur aspiration à la Paix.
|
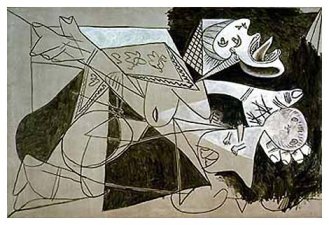
Picasso,
La madre y el niño muerto, 1937
|

Picasso, Gernica,
1937
|

Gonzalez, Monserrat
criant, 1942
|
L'art
dégénéré

Affiche de l'Exposition
d'art "dégénéré", Munich 1937
|
Le
terme Entartete Kunst (art dégénéré) fut
inventé par Goebbels pour désigner toutes les productions
artistiques qui ne correspondent pas aux critères esthétiques
des nazis.
Le
18 juillet 1938, Adolf Hitler et son ministre de la propagande, Joseph
Goebbels inaugurent à Munich la Maison de l'Art ainsi que la
"Grande exposition d'art allemand". Hilter utilise alors
se rendez-vous culturel annuel pour témoigner du triomphe et
de la supériorité de la race arienne jusque dans l'art,
avec plus de 600 pièces scrupuleusement séléctionnées
par Goebbels.

Goebbels
et Hilter à Munich, 1937 |
Bien
décidé à anéantir les dernières "survivances
de désintégrations culturelle" et autres traces de
la culture "judéo-bolchévique", Hilter inaugure
le lendemain, le 19 juillet 1937 l'exposition d'Entartete Kunst à
Munich. Par soucis de diffusion du message de propagande, l'expostion
effectuera un tournée dans tout le IIIe Reich jusqu'en 1941.
Le
parallélisme entre les deux expositions d'art était donc
une vaste manoeuvre de propagande nazie, la première annonçant
l'aube d'une nouvelle époque culturelle et la seconde dépeignant
l'éclipse d'une époque de "décadence et de chaos"
culturel.
Toutes
les toiles de l'exposition d'Entartete Kunst seront brûlées
publiquement.
Les
artistes allemands et des pays annexés par le IIIe Reich sont alors
forcés de s'exiler. D'abord réfugiés dans le reste
de l'Europe, ils sont très vite contraints de rejoindre le Royaume-Uni
ou les Etats-Uni.
L'art
pictural comptemporain est donc persécuté. Nombre d'artistes
paieront de leur vie leurs peintures, internés dans les camps comme
ennemis politiques.

Le
camp des Milles
Les
Milles fut le seul camp français à la fois d'internement,
de transit, puis de déportation. Ce camps était en fait une
tuileries, convertie en prison par la France dès la déclaration
de guerre pour y interner les ressortissants allemands. Mais il se trouve
que la majeure partie des ces allemands étaients des exilés,
savants, prix Nobels, antinazis et artistes peintres.
Même
si l'enfermement fut très mal ressenti, le camp des Milles va très
vite mettre en place une très grande activité culturelle.
D'un point de vue artistique, le camp des Milles présente un grand
interêt puisqu'il a enfermé quelques uns des plus grands artistes
allemands de l'époque (Alfred Otto Wolfgang Schuize, Hans Bellmer
Robert Liebknecht, Max Ernst), symbolisant la persécution des intellectuels
et la survie de l'art dans les camps.
Les
dessins et peintures du camps des Milles sont les premières preuves,
d'un point de vue chronologique, du traumatisme des hommes dans les camps.
L'environnement des camps, la proximité, les parasites, le désespoir
des hommes, ressortent clairement des croquis et des peintures de ce camps.
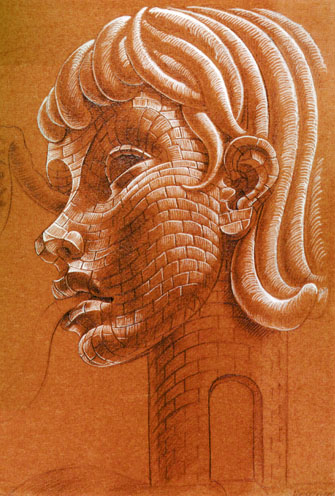
Hans
Bellmer, Tête de femme sur une tour, 1940 |
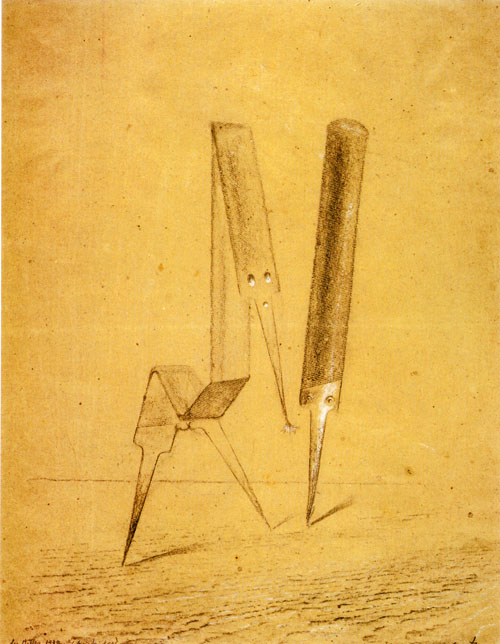
Max
Ernst, Les Apatrides, 1940
|
| 
Robert
Liebknecht, Bâtiment central du camp, 1939 |

Robert Liebknecht,
Personnage au camp, 1939
|

Wols,
Etude pour la puce, 1940
Il est
à noter que le rassemblement de ces oeuvre n'a été
possible que par le fait que le camps des Milles fut tenus par les français
jusqu'à l'armistice de juin 1940. Par la suite, les nazis se serviront
du camp, comme point de transit, puis comme gare de départ pour la
déportation. A partir de Septembre 1942, des milliers de juifs français,
livrés aux nazis par le gouvernement de Vichy, seront ainsi déportés
vers Auschwitz.
Malgré
les camps et la répression nazie, l'art pictural ne cessera pas d'exister
pendant la période concentrationnaire. Bien que clandestines, de nombreuses
oeuvres (croquis, portrait, peintures, gravures) seront produites dans les
camps. La plupart ont été retrouvés lors de la libérations
des camps, dans des cachettes au sein même des camps ou bien sur des
détenus, qui conservaient souvent au péril de leur vie.
Des
scènes de la vie quotidienne
La
plupart des dessins, peintures et gravures qui ont été retourvées
dans les camps de concentration et d'extermination représentent des
scènes de la vie quotidienne, de corvée. Distractions, témoignages,
cadeaux d'anniversaire, ces oeuvres étaient aussi et surtout des
exutoires à la douleur, à la souffrance, à l'horreur.
La création s'opposait alors à la destruction... L'art était
un défi lancé à la mort. En effet, toute création
dans les camps était souvent punie de mort, et les artistes, qui
gagnait souvent une certaine renommée dans leur camp, étaient
forcés de se cacher, dessinant la nuit, sous les lits, cachés
derrières leur camarades, évitant les rondes et les inspections
des "Lagers" et des capos. Il ne faut donc pa s'étonner
de l'état de certains de ses dessins, déchirés, estompés
ou entâchés.
Plus
de 30000 dessins on été retrouvés dans les camps lors
de leurs libérations, ce qui a permit d'identifier, de regrouper
et de reconstituer l'oeuvre de certains artistes.
Leo Haas
Leos
Haas est un exemple de la persécution des artistes dans les camps
de concentrations. Dessinateur de presse interné dans les camps pendant
la totalité de la guerre, il a survécu à Theresienstadt,
Auschwitz, Sachsenhausen et Mauthausen. Il fait partie de ses artistes clandestins
qui, malgré la repression et même la torture, est parvenu à
conserver ses dessins dans une cachette.
Leo
Haas survécu aux camps, et, après la libération, parvint
à récupérer ses dessins dans la cache dont il avait
soigneusement relevé l'emplacement.
|
Leo Haas,
Thérésine, 1943
|
Les
dessins de Leo Haas sont simples. Dépourvus de couleur et de graphisme
grossier, ils témoignent cependant avec force de l'horreur et de
l'ambiance des camps de concentration et d'extermination.
Après
la guerre, il revint au dessin comme caricaturiste dans la presse communiste.
Il fut aussi, toujours par l'intermédiaure de sont art, en grand
défenseur de la Paix pendant la guerre du Vietman. Devenu professeur
en 1966, il meurt en 1983 à Berlin.
Malvina
Schalkova
 |
Malvina
Schalkova fut déportée à Theresienstadt, puis
à Auschwitz, ou elle fut tuée. Ses dessins on néanmoins
été sauvés, et donne aujourd'hui un témoignage
de l'organisation des la vie dans le ghetto et dans les camps. Ses
dessins représentent pour la plupart des moments précis
de la vie dans ces ghettos et camps.
|
Portrait, natures mortes, paysage, scènes de vie,
les dessins de Malvina Schalkova sont comme des photographies. Dépourvus
de toute violence, la douceur de ses fusains et aquarelles contraste avec
l'agressivité et la grossièreté des traits de la plupart
des autres dessins.
| 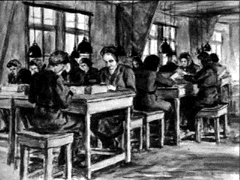
|
Des
femmes au travail |

|
Une
femme et son enfant |
| 
|
La
corvée de d"épluchage |

|
Le
repos dans les blocs |
| 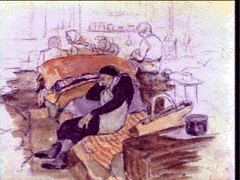
|
Un
vieil homme |

|
La
toilette d'une déportée |
Des
pièces à conviction
En plus des photos prise
à la libération des camps, les dessins récupérés
constituent de véritables pièces à conviction des horreurs
nazie et du fonctionnement des systèmes concentrationnaire et d'extermination
nazis.
Certains artistes ont
pu, armés de leur charbon de bois, prendre sur le vifs des scènes
d'horreurs et prendre note de actes de dégradation commis sur les
détenus. Chacun pouvait alors, à sa manière, selon
son point de vue, apporter au témoignage communs à tous les
détenus et victimes des nazis. Les enfants également, dont
certains dessins ont été retrouvés, ont participé
à ce témoignage.
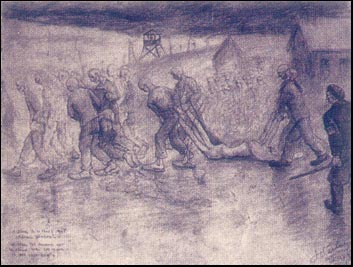
Léon
Delarbre, L'appel (morts compris), 1945
|
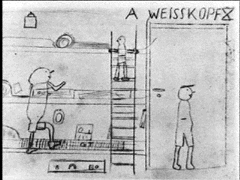
Dessin d'enfant
à Theresienstadt, 19??
|

Dessin d'enfant
à Theresienstadt, 1944
|

Contrairement
à l'opinion courante, les survivants aux camps de concentraion et d'extermination
n'ont pas mis beaucoup de temps à se livrer au témoignage. Ainsi,
de 1945 à 1948, toutes formes d'art confondues, il va il y avoir une
grande production artistique sur le sujet. La période post-concentrationnaire
se caractérise par sa grande expressivité. Les artistes
se sont attaché à retranscrire au mieux, au plus saisissant,
au plus percutant, les horreurs vécues pendant la déportation
ett l'extermination.
Maurice
de la Pintière
Survivant
du camp de Dora et artiste de talent, Maurice de la Pintière à
raconter son expérience au travers de croquis. Son oeuvre présente
des scènes de la vie quotidienne classiques, mais aussi et surtout
des scènes de mort, d'exécution, et du dur labeur des kommandos.
Etudiant
des Beaux-Arts, Maurice de la Pintière à regroupé la
majeure partie de son oeuvre sous le nom de "Dora, la mangeuse d'hommes",
constituée de reproduction de lavis fait en 1945. Son oeuvre est
un des témoignages picturaux les plus connus, tant par force du témoignage
que par la qualité des dessins.
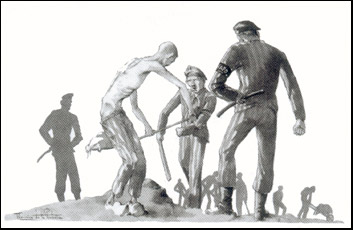
Maurice
de la Pintière, Où chaque pelletée de terre
était mouillée de leurs larmes et de leur sang,
1945
|
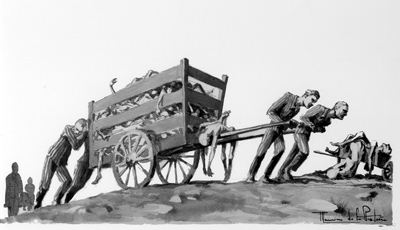
Maurice
de la Pintière, Le kommando de la mort, 1945
|
Zoran Music, accusé
d'appartenir à la résistance, fut interné au camp
de Dachau, où il réalisa, au péril de sa vie, des
centaines de dessins décrivant l'horreur qu'il voyait : scènes
de pendaison, fours crématoires, cadavres.
De 1970 à 1975,
Zoran Music revint à Dachau, dans les murs même où
il fut enfermé de 1943 à 1945. Il peint et grave alors une
série d'oeuvre regroupée sous le nom de "Nous ne sommes
pas les derniers".
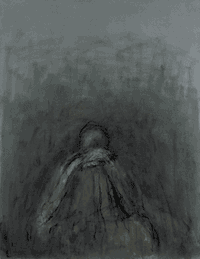
Zoran Music,
Nous ne sommes pas les derniers (extrait), 1970-1975
|

Zoran Music,
Nous ne sommes pas les derniers (extrait), 1970-1975
|

Zoran Music,
Nous ne sommes pas les derniers (extrait), 1970-1975
|
Ces
oeuvres, non illustratives sont un nouveau témoignage exeptionnel
de la déportation, et exprime parfaitment la douleur et les souffrances
endurées.